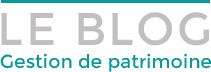Les clauses d’aménagement des régimes communautaires à leur dissolution et des régimes séparatistes
Rédaction WEB : JUST DEEP CONTENT
Les clauses d’aménagement des régimes matrimoniaux permettent de définir un régime matrimonial sur mesure. Le point dans ce deuxième article sur les clauses d’aménagement des régimes communautaires à leur dissolution et des régimes séparatistes.
Nous avons pu étudier dans notre article précédent l’aménagement des régimes matrimoniaux communautaires par des clauses particulières produisant leurs effets pendant le mariage.
D’autres clauses permettent d’organiser la dissolution du régime communautaire par décès ou par divorce. Enfin, certaines clauses permettent d’aménager spécifiquement les régimes séparatistes. Explications dans ce second article.
SOMMAIRE
- Les clauses d’aménagement des régimes communautaires prenant effet à la dissolution du mariage en cas de décès
- Les clauses d’aménagement des régimes communautaires prenant effet à la dissolution du mariage en cas de décès ou de divorce
- Les clauses d’aménagement des régimes de la séparation de biens et de la participation aux acquêts
Les clauses d’aménagement des régimes communautaires prenant effet à la dissolution du mariage en cas de décès
Ces clauses, relativement nombreuses, permettent d’organiser la succession et notamment la protection du conjoint survivant en régime de communauté.
La clause d’attribution intégrale en propriété de la communauté
Gain de survie, cette clause (C.civ. art 1524) autorise le survivant des époux à recueillir l’ensemble des biens communs. La succession du prédécédé est « vidée de sa substance » et le survivant des époux devient immédiatement propriétaire de l’intégralité de la communauté.
A noter :
Le conjoint survivant doit accepter ou refuser l’intégralité de la communauté contrairement à la clause de préciput où il peut exercer sa faculté de cantonnement.
La clause d’attribution intégrale en propriété de la communauté peut être prévue dans tout régime de communauté conventionnelle.
En présence d’enfants communs, cet avantage matrimonial n’est pas soumis à réduction, le survivant des époux est investi d’un droit absolu sur l’ensemble des biens.
Les biens devenant instantanément propriété du conjoint survivant, aucune déclaration de succession n’a à être établie et seuls sont dressés l’acte de notoriété constatant l’absence d’enfants susceptibles d’exercer l’action en retranchement et l’attestation immobilière qui constate la propriété des biens au nom du seul survivant.
Corrélativement, le passif est transmis dans son intégralité sans que le conjoint ne puisse se prévaloir du bénéfice d’émolument.
La clause d’attribution intégrale concerne au premier chef les couples sans enfant désireux de protéger exclusivement leur conjoint et de lui faciliter au maximum les formalités de transmission (absence de déclaration de succession).
En présence d’enfants communs :
- Les enfants perdent l’abattement en ligne direct (100.000 €) au premier décès qui peut être compensé par des donations simples ou des donations-partages du vivant des époux.
- L’attribution intégrale peut se faire en usufruit de manière à ce que les enfants récupèrent la pleine propriété au décès du second époux.
Deux règles peuvent réduire l’avantage matrimonial dont bénéficie le conjoint survivant.
- La reprise des apports (civ. art.1525, al.2)
Les héritiers du défunt peuvent faire la reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de leur auteur.
Les apports et capitaux sont :
- Les biens que possédait le défunt au jour du mariage
- Les biens qu’il a reçus par succession ou libéralité pendant le mariage et tombés en communauté.
L’exercice de ce droit de reprise est donc cantonné aux seuls acquêts.
Les dettes grevant ces apports sont à la charge des successeurs qui exercent la reprise.
A noter :
Ce droit de reprise s’exerce aussi en cas de clause de stipulation de parts inégales.
Les époux peuvent prévoir une clause stipulant l’interdiction de cette reprise.
- L’action en retranchement (civ. art. 1527, al.2) :
En présence d’enfants qui ne sont pas issus des deux époux, l’avantage est réductible s’il porte atteinte à la réserve de ces enfants.
En effet, les enfants communs du couple ayant vocation à recueillir dans la succession de leur second parent l’avantage concédé au premier décès, les enfants non issus des deux époux seraient privés au second décès de tout droit dans la succession.
L’effet de l’action en retranchement est de limiter l’avantage matrimonial à la quotité disponible spéciale entre époux prévue à l’article 1094-1 du Code civil.
Ils peuvent donc à la fois retirer de la communauté les biens apportés par leur auteur et réduire l’avantage matrimonial à la quotité disponible spéciale entre époux.
Point sur la renonciation à la succession et à l’action en réduction
La renonciation pure et simple :
Un héritier peut renoncer purement et simplement à la succession auquel cas le conjoint survivant recueille l’intégralité de la succession.
La renonciation anticipée à l’action en réduction (C.civ. art. 1527, al.3) :
Afin que le conjoint puisse bénéficier de l’avantage matrimonial, les enfants non issus des deux époux peuvent différer l’exercice de l’action en retranchement au décès du conjoint survivant. Ils recueilleront ainsi leur réserve au décès de l’époux survivant. Ce n’est pas une renonciation à proprement parler puisque son exercice en est différé.
La renonciation anticipée à l’action en réduction n’est donc pas une renonciation à la réserve, l’héritier renonçant restant pris en compte pour le calcul de la réserve globale et de la quotité disponible.
La clause de préciput
La clause de préciput (de praebere : fournir avant), autorise le survivant des époux ou l’un d’eux, s’il survit, à prélever sur la communauté avant tout partage, soit une certaine somme, soit certains biens en nature, soit une certaine quantité d’une espèce déterminée de biens, meubles ou immeubles (C.civ. art. 1515, 1516, 1518).
Comme l’attribution intégrale de la communauté ou la stipulation de parts inégales, le préciput n’est pas limité à la réserve des descendants en présence d’enfants communs.
Contrairement à d’autres avantages matrimoniaux (attribution intégrale de la communauté, stipulation de parts inégales), lesquels obligent le survivant à recueillir l’intégralité de ce qui leur ait dévolu, cette clause offre la possibilité au conjoint survivant de choisir les biens qu’il désire recueillir dans la succession en fonction de ses besoins et de ses objectifs. Grâce à ce cantonnement successoral (C.civ. art. 1094-1, al. 2), le survivant des époux peut ainsi augmenter l’émolument reçu par les autres cohéritiers.
Exemple :
Le conjoint survivant pourra « abandonner » aux cohéritiers tel bien immeuble qui ne produit pas de revenus, le capital d’un contrat d’assurance-vie financé par des fonds communs, se dénouant au premier décès, et dont l’époux survivant est le bénéficiaire de premier rang, sans que ces renonciations soient considérées comme des donations.
A noter :
En présence de contrats d’assurance-vie financés par des deniers communs non-dénoués au premier décès et dont le souscripteur assuré est le conjoint survivant, ce dernier peut recevoir la totalité des capitaux grâce à la clause de préciput, la valeur de rachat du contrat n’étant pas réintégrée civilement à l’actif de la communauté.
En présence d’enfants qui ne sont pas issus des deux époux, la clause de préciput conserve sa validité et la faculté de cantonnement permet de limiter l’émolument du survivant à la quotité disponible spéciale entre époux (C.civ. art. 1094-1, art. 1527 al. 2). Le conjoint survivant peut choisir ainsi les biens qui servent ses besoins et ses objectifs.
Dans un arrêt récent (Cour d’appel Poitiers, 4 juillet 2023 RG n° 22/01034), la Cour d’appel de Poitiers a confirmé que l’exercice de la clause de préciput s’opère avant tout partage tel que le stipule l’article 1515 du Code civil et que cet exercice n’est pas soumis au droit de partage.
La faculté d’acquisition ou d’attribution
Déclinaison de la clause de prélèvement moyennant indemnité, cette clause (C.civ. art. 1390) peut être stipulée sur des biens propres dans les régimes communautaires ou sous un régime séparatiste, sur des biens personnels de l’époux prédécédé.
Elle est appelée « clause commerciale » lorsque son objet porte sur un fonds de commerce ou une entreprise familiale par exemple, elle permet au conjoint bénéficiaire d’échapper au tirage au sort des lots lors du partage.
La jurisprudence considère qu’elle prévaut sur les règles légales de l’attribution préférentielle (C.civ. art 831 ss.) qui ne sont pas d’ordre public (Cass. 1ère civ. 14 février 1967).
Attribution préférentielle conventionnelle, elle ne procure pas d’«enrichissement» au conjoint survivant comme la clause de préciput, la clause d’attribution intégrale de la communauté ou la stipulation de parts inégales.
Les clauses d’aménagement des régimes communautaires prenant effet à la dissolution du mariage en cas de décès ou de divorce
Certaines clauses d’aménagement des régimes communautaires prennent effet quelle que soit la cause de la dissolution du mariage : décès ou divorce.
La clause de stipulation de parts inégales
Les époux peuvent déroger au partage égal établi par la loi. Ils peuvent aussi bien choisir de réduire que d’augmenter la part du survivant d’entre eux jusqu’à aboutir à l’attribution de la communauté entière.
Cette clause (C.civ.art. 1520, 1521), qui peut s’appliquer en cas de divorce, est le plus souvent utilisée en cas de décès. Elle permet d’anticiper la répartition des biens entre le conjoint survivant et les héritiers.
Au même titre que l’attribution intégrale de la communauté, elle doit être acceptée ou refusée pour le tout.
A noter :
Les héritiers du prédécédé conservent le droit de reprise des apports tombés dans la communauté du chef de leur auteur qui peut être supprimé par une clause contraire.
Le conjoint survivant et les héritiers supportent les dettes de la communauté à proportion de leur part d’actif recueilli.
Le prélèvement moyennant indemnité
Le prélèvement moyennant indemnité (C.civ. art 1511 ss) permet à l’un des époux de prélever certains biens communs « à charge d’en tenir compte d’après la valeur qu’ils auront au jour du partage », que le mariage soit dissous par le décès de l’un des époux ou pour une autre cause.
Les biens prélevés par l’époux sont imputés sur sa part. Si leur valeur excède cette part, il y a lieu au versement d’une soulte.
Les époux peuvent aussi prévoir que l’indemnité due par le survivant s’imputera sur ses droits dans la succession du défunt.
En pratique, la clause ne s’exerce qu’en cas de décès et vise souvent la résidence principale, mais elle peut permettre de protéger l’entreprise d’un époux en cas de divorce ou de séparation de corps.
En cas de décès, le survivant des époux se trouve propriétaire des biens sans qu’aucun partage n’ait à être fait.
A noter :
Le prélèvement moyennant indemnité n’est pas considéré comme un avantage matrimonial si l’indemnité correspond à la valeur du bien, sauf à ce que la méthode d’évaluation confère un profit au bénéficiaire.
La clause d’exclusion des biens professionnels ou de stipulation de propre
La clause d’exclusion des biens professionnels permet d’exclure de la masse commune des biens tels que les fonds de commerce, les exploitations, les clientèles civiles qui seraient acquis ou crées par un époux pendant le mariage.
Elle permet, en cas de divorce ou de séparation de corps des époux, de protéger l’entreprise.
Cette stipulation de propre peut se faire à titre gratuit ou à titre onéreux.
A noter :
Le bien n’est exclu de la communauté qu’en propriété, cette dernière en conservant la valeur. Ce droit se traduit par une récompense à la communauté le jour de la liquidation. Pour exclure le bien de la communauté en propriété et en valeur, il convient donc de supprimer tout droit à récompense quels que soient le mode d’acquisition et l’origine des fonds employés à cette acquisition.
La clause de liquidation alternative
En cas de divorce, les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage, par exemple, l’apport à la communauté de biens propres ou l’adoption de la communauté universelle, sont maintenus (C.civ. art 265, al.1).
D’autres avantages matrimoniaux, tels que la stipulation de parts inégales, la clause de préciput, la clause d’attribution intégrale, sont considérés comme des gains de survie et ne prennent effet qu’à la dissolution du mariage par décès et sont alors révoqués de plein droit en cas de divorce (C.civ. art.265, al. 2).
La clause de reprise des apports faits à la communauté permet aux époux de reprendre en nature les biens apportés à la communauté en cas de divorce, ce qui annule les effets des avantages matrimoniaux qui seraient maintenus (C.civ. art.265, al. 3).
A noter :
Les époux peuvent aussi choisir de ne pas stipuler cette clause de reprise des apports auquel cas les avantages matrimoniaux prenant effet au cours du mariage sont maintenus en cas de divorce.
Les clauses d’aménagement des régimes de la séparation de biens et de la participation aux acquêts
Certaines clauses concernent exclusivement les régimes séparatistes.
Les clauses aménageant la séparation de biens
On distingue principalement trois aménagements différents.
La clause de présomption de propriété
Il est fréquent que les époux séparés de biens incluent, dans leur contrat de mariage ou dans la convention modificative, un inventaire de leurs biens personnels.
Ces clauses de « présomption de propriété » concernent essentiellement les biens meubles car « les biens sur lesquels aucun époux ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié » (C.civ. art. 1538, al. 3).
Ils peuvent également déclarer indivis certains biens acquis avant le mariage ou à titre de libéralité par contrat de mariage.
La faculté d’acquisition ou d’attribution
Cette clause permet à l’époux survivant de recueillir dans la succession certains biens personnels du défunt à charge de tenir compte de leur valeur le jour où cette faculté sera exercée.
Elle porte souvent sur la résidence principale, le mobilier la garnissant, un fonds de commerce.
Elle peut être stipulée par testament.
La société d’acquêts
L’adjonction d’une société d’acquêts au régime de la séparation de biens permet de créer une communauté de biens dont les époux définissent le contenu et les règles de gestion.
La société d’acquêts à objet limité ou « à titre particulier » est la forme la plus fréquente de la société d’acquêts. Elle porte sur un ou plusieurs biens déterminés dès sa constitution ou sur une catégorie de biens : le logement familial, les comptes-joints, les droits sociaux…
Les biens composant la société d’acquêts peuvent être des biens appartenant actuellement aux époux mais aussi des biens futurs qui seront mentionnés précisément dans l’acte afin d’établir définitivement leur qualification d’acquêts.
Outre les biens en pleine propriété, les époux peuvent apporter l’usufruit de certains biens à la société d’acquêts. Si l’usufruit a été constitué sur la tête des deux époux, il subsiste au décès du premier époux et confère au survivant la jouissance d’un bien lui permettant de maintenir son train de vie et/ou son cadre de vie.
Au même titre que l’apport en communauté, l’apport de biens meubles ou immeubles personnels à la société d’acquêts constitue un avantage matrimonial prenant effet pendant le mariage (Cass. 1ère civ. 29 novembre 2017, n° 16-29.056).
Les acquêts sont gérés comme des biens communs, les règles de la communauté sont également appliquées au passif, à la dissolution, à la liquidation et au partage de la société d’acquêts.
Une clause de préciput ou de partage inégal peut être stipulée pour les biens dépendant de la société d’acquêts afin d’augmenter les droits successoraux du conjoint survivant.
La participation aux acquêts
Ce régime hybride fonctionne comme une séparation de biens pendant le mariage et se liquide à sa dissolution comme une communauté d’acquêts mais en valeur.
L’objectif de ce régime est, qu’à sa dissolution, un des époux bénéficie de l’accroissement du patrimoine réalisé par l’autre conjoint.
Les clauses d’aménagement les plus fréquentes sont :
- La clause de partage inégal qui, en pratique, est réservée au survivant des époux.
- Le droit à la totalité des acquêts nets faits par le défunt.
- La clause d’exclusion des biens professionnels en cas de divorce.
La Cour de cassation a considéré à plusieurs reprises qu’une clause d’exclusion des biens professionnels du calcul de la créance de participation stipulée dans un contrat de participation aux acquêts constituait un avantage matrimonial au sens de l’alinéa 2 de l’article 265 du Code civil et qu’il devait être révoqué au moment du divorce (Cass. 1ère civ., 18 décembre 2019- Pourvoi N° 18-26.337, Cass. 1èreciv. 31 mars 2021, N° 19-25.903).
Cette décision invalide ce type de clause qui n’a de sens qu’en cas de divorce.
Pourtant, dans différents rapports, la Cour de cassation a, elle-même, suggéré de modifier l’article 265 du Code civil.
Une proposition de loi « visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille » (N° 1961) a été adoptée par l’Assemblée nationale le 18 janvier 2024.
L’article 1er bis nouveau de cette proposition de loi prévoit l’ajout d’un nouvel alinéa : « La clause d’exclusion des biens professionnels du calcul de la créance de participation ne constitue pas un avantage matrimonial qui est révoqué de plein droit par le divorce. »
La clause d’exclusion des biens professionnels du calcul de la créance de participation en cas de divorce est ainsi légalement validée.
Grâce à la grande variété des clauses d’aménagement des régimes matrimoniaux et à leur adaptabilité à tous les objectifs patrimoniaux, les couples mariés ont la possibilité de choisir un régime matrimonial « sur mesure » ou d’adapter et d’actualiser leur régime existant à leurs attentes, à l’évolution de leur patrimoine et à leur situation familiale.
Le rôle du conseil est de les aider à déterminer celles qui répondent à leurs objectifs, respectent l’intérêt de leurs familles et les protègent pendant et après la vie conjugale.
Auteur
Conseil en gestion de patrimoine – Intervenant formateur pour le CESB CGP, diplôme RNCP Niveau 7, spécialisé en gestion de patrimoine.
Sources :
- C.civ. art 1524
- C.civ. art.1525, al.2
- C.civ. art. 1527, al.2
- C.civ. art. 1527, al.3
- Article 1094-1 du Code civil
- C.civ. art. 1094-1, al. 2
- C.civ. art. 1515, 1516, 1518
- C.civ. art. 1390
- C.civ. art 831 ss.
- C.civ.art. 1520, 1521
- C.civ. art 1511 ss
- C.civ art 265
- C.civ. art. 1538, al. 3
- Cour d’appel Poitiers, 4 juillet 2023 RG n° 22/01034
- Cass. 1ère civ. 14 février 1967
- Cass. 1ère civ. 29 novembre 2017, n° 16-29.056
- Cass. 1ère civ., 18 décembre 2019- Pourvoi N° 18-26.337
- Cass. 1èreciv. 31 mars 2021, N° 19-25.903
- Proposition de loi « visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille » (N° 1961)