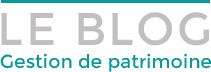Co-souscription d’un contrat d’assurance-vie avec dénouement au second décès : attention à la dichotomie civile et fiscale
L’arrêt récent de la Cour de cassation du 26 juin 2019 vient de rappeler un point important concernant les contrats d’assurance-vie en co-souscription, alimentés par des fonds communs, avec dénouement au second décès.
Ce type de contrat, bien que se poursuivant au nom du co-souscripteur survivant, n’est pas un bien propre de ce dernier mais fait bien partie, au premier décès de l’un des époux, de l’actif de communauté et donc de l’actif successoral pour moitié de sa valeur.
Les effets civils et fiscaux sur la succession ne sont cependant pas les mêmes (Réponse ministérielle Ciot) et dans certains cas un risque fiscal peut être encouru. Explications.
Contexte
La co-souscription d’un contrat d’assurance-vie, alimenté par des fonds communs offre, sous certaines conditions, la possibilité de se dénouer au décès du second époux si cette option est choisie.
D’un point de vue civil
La question que l’on serait légitiment en droit de se poser est de savoir si la valeur de rachat du contrat, au décès du premier époux, constitue un propre pour l’époux survivant ou un actif de communauté qu’il convient d’intégrer à son actif.
La Cour d’appel d’Agen, à travers un arrêt du 13 juin 2018, a décidé, à tort, que le conjoint survivant était bénéficiaire dudit contrat d’assurance-vie (!) et que ce dernier constituait, pour lui, un propre.
La Cour de cassation a censuré cet arrêt par une décision du 26 juin 2019. Elle précise, a contrario, que le contrat ne s’est pas dénoué car il a perduré sur la tête du conjoint survivant. A ce titre, il forme un actif de communauté dont la valeur de rachat doit y être intégrée.
En savoir plus :
Cet arrêt de la Cour de cassation est en phase avec la réponse ministérielle PRORIOL du 10 novembre 2009. En effet, cette réponse ministérielle était venue nous préciser que, sous réserve de l’appréciation souveraine des juges du fond, il n’y avait pas lieu de remettre en cause l’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 31 mars 1992 (affaire Praslicka), qui a déclaré que « la valeur de rachat fait partie des biens communs, conformément à l’article 1401 du Code civil. »
Le contrat d’assurance-vie alimenté par des fonds communs et non dénoué au décès du premier des époux constitue donc un bien commun qu’il y a lieu d’intégrer à l’actif de communauté.
A ce titre, lors d’un partage post-successoral, la valeur de rachat de ce contrat d’assurance-vie non dénoué devra faire partie de la masse à partager.
En savoir plus :
D’un point de vue fiscal
Il en est tout autrement.
En effet, depuis la réponse ministérielle CIOT du 23 février 2016, reprise au BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20 n° 380, la valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie, souscrit avec des deniers communs et non dénoué au décès du premier époux, n’est pas intégrée à l’actif de la communauté taxable.
En savoir plus :
La non-prise en compte de la valeur de rachat de ce contrat, d’un point de vue fiscal, ne s’applique que pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016.
Il est intéressant de remarquer que pour les successions ouvertes avant cette date, l’administration fiscale refuse de prendre en compte cette réponse ministérielle CIOT ; elle n’a donc pas d’effet rétroactif (réponse ministérielle LAQHILA du 13 novembre 2018). Les déclarations de succession concernant les décès survenus avant le 1er janvier 2016 comprennent donc en actif de communauté la valeur de rachat de ces contrats non dénoués.
En savoir plus :
Exemple chiffré
Pierre DURAND est décédé en juin 2019 en présence d’un contrat d’assurance-vie co-souscrit avec son épouse et alimenté par des fonds communs. Il laisse, pour lui succéder, son épouse Marcelle et deux enfants communes Emma et Léonie.
Monsieur et Madame DURAND étaient mariés sous le nouveau régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts, à défaut de contrat de mariage.
Aucune donation n’a été consentie par Monsieur et Madame DURAND à leurs enfants.
Les actifs de communauté représentent une valeur de 750.000 €.
La valeur de rachat du contrat d’assurance-vie, au décès de Pierre, est de 238.000 €.
Marcelle a choisi l’option du 1/4 en pleine propriété.
Liquidation civile
La masse à partager comprend :
- Les biens existants au décès pour 750.000 €
- La valeur de rachat du contrat non dénoué pour 238.000 €
- Soit un total d’actifs de communauté de 988.000 €
- Soit un total d’actif successoral de ½ soit 494.000 €
Revenant à :
- A Marcelle pour 1/4, soit 123.500 €
- A Emma et Léonie, pour les 3/4 de surplus, soit 370.500 €, et pour chacune d’elles 185.250 €
Liquidation fiscale
L’actif de communauté est de 750.000 €. L’actif de succession ressort à 375.000 €, revenant :
- A Marcelle pour 1/4, soit 93.750 €. Droits de succession : 0 € (conjoint survivant exonéré)
- A Emma et Léonie, pour les ¾ du surplus, soit 281.250 €, et pour chacune d’elles : 140.625 €. Droits de succession : 12.638 € au total pour Emma et Léonie.
Les valeurs civiles et fiscales des parts successorales de chaque héritier sont donc totalement différentes.
| Droits civils dans la masse successorale | Droits fiscaux Assiette des droits de succession | Droits de succession | |
|---|---|---|---|
| Marcelle DURAND | 123.500 € | 93.750 € | Aucun pour le conjoint survivant |
| Emma et Léonie DURAND | 370.500 € | 281.250 € | 12.638 € |
Particularités et risques fiscaux de l’absence de partage de succession
- Marcelle a des droits civils de 123.500 €.
- Emma et Léonie ont ensemble des droits civils de 370.500 €.
Si aucun partage post-successoral n’est réalisé, comme cela est très souvent le cas en pratique, Marcelle conservera le contrat d’assurance-vie non dénoué comme étant seule souscriptrice-assurée.
Contrat d’assurance-vie, est-il nécessaire de le rappeler, qu’elle pourra intégralement consommer voire, dans l’absolu, désigner des bénéficiaires autres que ces enfants.
De là à considérer que nous sommes en présence d’une donation indirecte au profit de Marcelle, au détriment de Emma et Léonie, il n’y a qu’un pas…. Pas que l’administration fiscale a fait puisque la réponse ministérielle MALHURET du 10 janvier 2019 précise que « (…) Cette réponse (réponse ministérielle CIOT), qui porte ainsi sur la détermination de l’actif successoral pour l’établissement des droits dus par les héritiers de l’époux prédécédé, est sans incidence sur la qualification éventuelle de donation indirecte, taxable aux droits de mutation à titre gratuit au nom du donataire, de la transmission réalisée via le contrat d’assurance vie au bénéfice de l’autre conjoint. Elle ne saurait donc permettre de présumer qu’un contrat co-souscrit par des époux communs en biens dont le dénouement normal est le décès du second conjoint ne peut constituer une donation indirecte. En effet, de manière générale, la souscription d’un contrat d’assurance-vie est susceptible de constituer une donation indirecte en l’absence d’éléments contredisant l’intention libérale du souscripteur. (…) »
En savoir plus :
Le développement ci-dessus s’applique également aux contrats d’assurance-vie en mono-adhésion du conjoint survivant alimentés par des fonds communs et non dénoués au décès du premier des époux.
Conclusion
L’intégration à la communauté du contrat d’assurance-vie non dénoué, et son rapport de facto à la succession pour la moitié de sa valeur, vient donc d’être récemment confirmé par cet arrêt de la Cour de Cassation du 26 juin 2019.
Ce mécanisme n’est que civil et n’a pas d’impact fiscal pour le calcul des droits de succession à payer, entraînant ainsi une dichotomie de traitement lors du règlement la succession.
Au-delà de cet aspect, un risque fiscal de requalification en donation indirecte demeure et peut être encouru lorsque le partage successoral n’est pas réalisé.
Le partage civil, après le décès du premier des deux époux, ou l’insertion d’une clause de préciput (article 1515 du code civil), dans un contrat de mariage, sur les contrats d’assurance-vie alimentés par des fonds communs et non dénoués sont alors les ultimes réponses civiles au risque fiscal soulevé !
Sources :
- Cour de Cassation, Chambre civile 1, 26 juin 2019, 18-21.383
- Réponse Ministérielle PRORIOL N° 27 336 du 10 novembre 2009
- Cour de Cassation, Chambre civile 1, 31 mars 1992, 90-16.343
- Réponse Ministérielle CIOT N° 78192 du 23 février 2016
- Réponse Ministérielle LAQHILA N° 1594 du 13 novembre 2018
- Réponse Ministérielle MALHURET N° 00256 du 10 janvier 2019
Auteur
Emmanuel Bouvenot ![]()
Ingénieur Patrimonial – BPE La banque privée de La Banque Postale