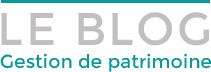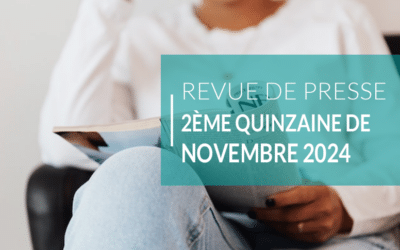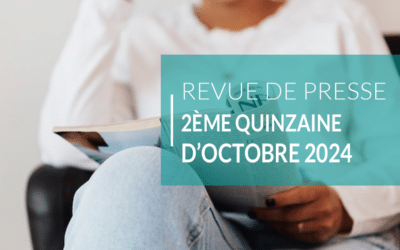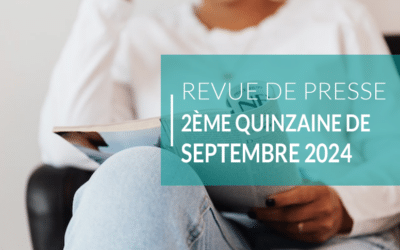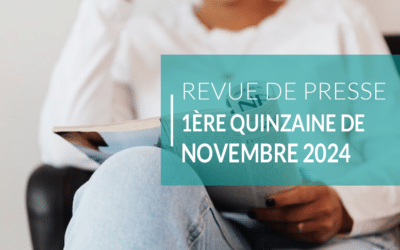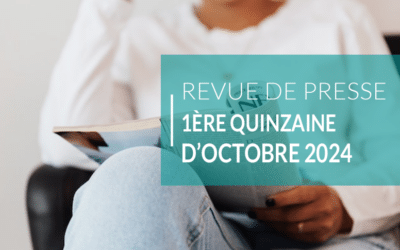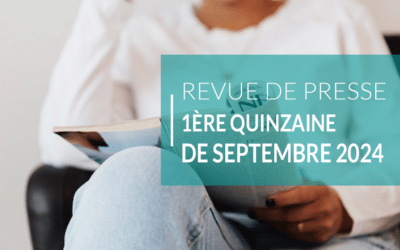GESTION DE PATRIMOINE
Des synthèses portant sur tous les thèmes utiles à votre métier
Revue de presse – Les tokens, Le bitcoin, Les fonds Climat, L’évolution du taux d’épargne
Au sommaire ce mois-ci : Les tokens, Le bitcoin, Les fonds Climat, L’évolution du taux d’épargne… Et plus encore !
Revue de presse – Nouveaux records : Crypto-actifs, Or, ETF, CLO
Au sommaire ce mois-ci : Nouveaux records Crypto-actifs, Or, ETF, CLO… Et plus encore !
Revue de presse – financement durable, épargne, marché, bourse
Au sommaire ce mois-ci : financements durables, l’épargne financière des ménages français, l’état des marché….Et plus encore !
Revue de presse – Le pacte Dutreil, Philatélie, Retraite, Impôts, Bourse
Au sommaire ce mois-ci : Le pacte Dutreil, Philatélie, Retraite, Impôts, Bourse… Et plus encore !
Revue de presse – Impôts, PER ou PEE, AMF, Fiscalité
Au sommaire ce mois-ci : Impôts, PER ou PEE, AMF, Fiscalité, ETF : meilleur trimestre jamais enregistré… Et plus encore !
Revue de presse – 1ère quinzaine de septembre 2024
Au sommaire ce mois-ci : Pinel : l’heure des comptes, Plus d’un milliard de dollars sortent des ETF bitcoin en une semaine, Un marché actions martyrisé, mais un marché actions libéré ….Et plus encore !